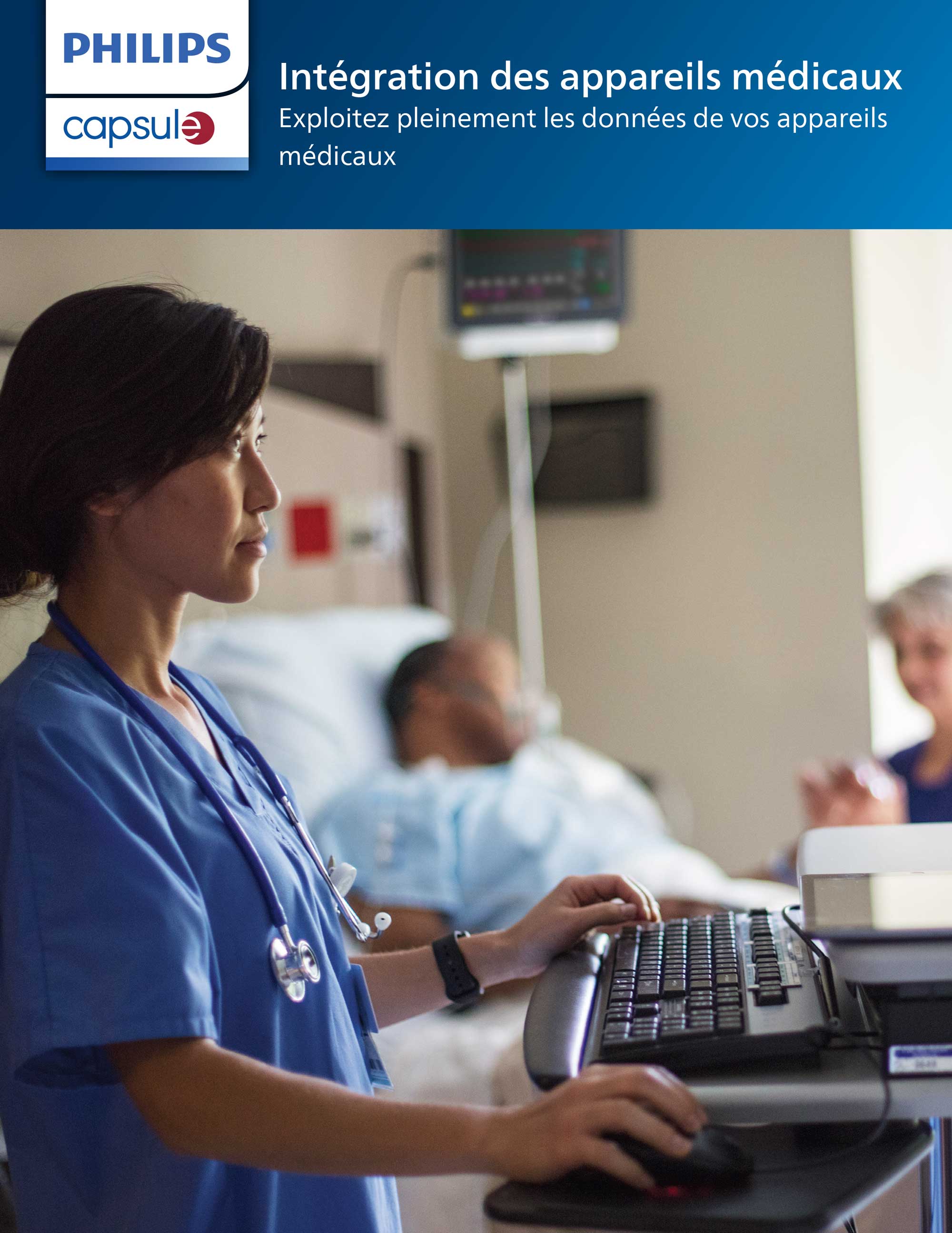Dans un article précédent, nous avons expliqué comment le personnel informatique et biomédical peut surmonter les défis techniques liés à la mise en œuvre d’une connectivité des appareils médicaux, agnostique vis-à-vis des fournisseurs, pour répondre aux besoins des praticiens dans un environnement de soins de santé complexe.
Dans cet article, nous nous intéressons aux avantages cliniques et aux raisons d’envisager une connectivité des appareils médicaux, agnostique vis-à-vis des fournisseurs, lors de la mise en œuvre d’une solution complète de diffusion de données en direct et haute-fidélité.
Tirer parti des connaissances basées sur les données
Les études indiquent que 99 % des données stockées sur les appareils médicaux ne sont pas ajoutées aux dossiers médicaux électroniques (DME)1. Ces données restent cloisonnées entre différents services et unités de soins, sur des appareils spécifiques ou sur les systèmes d’information et les plateformes des fabricants.
L’automatisation de la capture des données stockées sur ces appareils médicaux et leur partage avec les DME et d’autres systèmes d’information clinique offrent au personnel soignant une image plus complète de la santé du patient. Il peut en résulter un diagnostic facilité, une amélioration des flux de travail cliniques opérationnels et une meilleure collaboration entre les soignants intervenant sur différents sites.
Quels sont les autres avantages de l’intégration des données stockées sur les appareils médicaux ? En analysant les données, les hôpitaux pourraient repérer des modèles et des tendances aux fins suivantes :
- améliorer la gestion des alarmes ;
- mieux anticiper les signes de détérioration des patients ou les événements émergents ;
- informer la recherche médicale ;
- soutenir la gestion de la santé de la population.
Par ailleurs, la prise en compte des données connectées provenant des appareils de surveillance à distance des patients pourrait potentiellement permettre au personnel soignant de prévenir les réadmissions à l’hôpital grâce à une intervention précoce. La capture automatique des données stockées sur les appareils médicaux réduit également la charge administrative du personnel clinique tout en diminuant les risques d’erreurs de transcription et d’informations manquantes.
Il n’y a donc rien de surprenant à ce que la connectivité des appareils médicaux fonctionne mieux lorsque les utilisateurs cliniques bénéficient facilement de ses avantages. Découvrons des exemples concrets de patients.
TÉMOIGNAGES DE PATIENTS
Au bloc opératoire
Imaginez un infirmier anesthésiste certifié (IAC) qui surveille les signes vitaux et la médication d’un patient sous sédation au bloc opératoire.
Ce patient, comme beaucoup d’autres, est intubé et sédaté. Des analgésiques et des blocages neuromusculaires lui sont administrés tandis que ses voies aériennes et sa respiration sont maintenues par la machine d’anesthésie. L’IAC surveille la pression artérielle, la fréquence cardiaque et l’électrocardiogramme (ECG), ainsi que le niveau de sédation et d’autres signes pour détecter des changements.
Le contrôle approprié des doses de sédatifs et d’analgésiques permet de garantir une sédation adéquate. La fréquence d’administration des médicaments est également essentielle à une bonne gestion des soins. Les appareils médicaux doivent être synchronisés avec les horloges de l’hôpital. Dans le cas contraire, les horodatages associés aux différents signes vitaux risquent de ne pas indiquer l’heure exacte à laquelle ils ont été obtenus. Il est nécessaire de coordonner précisément les horodatages des signes vitaux avec l’administration des médicaments afin de déterminer correctement la sédation adéquate par rapport aux indications de douleur exprimées par le patient, notamment par l’intermédiaire des modifications de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. La connectivité des appareils permet de coordonner et d’attribuer des horodatages communs à toutes les valeurs collectées automatiquement. Les horodatages précis des résultats sont ainsi correctement associés au registre d’administration des médicaments. L’IAC bénéficie ainsi d’une fréquence de mesure précise, gage d’une meilleure gestion des soins apportés au patient.
Dans le laboratoire de cathétérisme
Victime d’un infarctus du myocarde antérieur (IMA), un patient est amené au laboratoire de cathétérisme de l’hôpital, pour une intervention coronarienne percutanée (ICP) d’urgence, incluant la pose d’un stent. Le médecin urgentiste lit l’ECG à 12 dérivations du moniteur cardiaque réalisé dans l’ambulance, avant l’hospitalisation et en vue de l’arrivée aux urgences. Il confirme la présence d’une élévation du segment ST et de changements réciproques. L’arrivée du patient étant imminente, le laboratoire de cathétérisme est préparé et l’équipe chirurgicale se tient prête à l’accueillir immédiatement.
Grâce à la connectivité des appareils médicaux, les formes d’ondes ECG et les signes vitaux sont partagés avec le médecin urgentiste et l’équipe du laboratoire de cathétérisme. De plus, le personnel hospitalier peut optimiser le traitement et la prise en charge des patients en accédant aux horodatages des médicaments administrés en dehors de l’hôpital.
En soins intensifs chirurgicaux
Au même moment, un autre patient est en cours de sevrage de la ventilation artificielle postopératoire dans l’unité de soins intensifs chirurgicaux (SICU). Les appareils médicaux connectés communiquent les réglages du respirateur mécanique et les paramètres spontanés du patient, ainsi que les données de monitorage cardiaque, afin que le médecin traitant et les cliniciens en thérapie respiratoire puissent évaluer si le patient est pris en charge de manière adéquate pendant les essais de respiration spontanée.
Le personnel soignant examine les tendances de la ventilation et les résultats de laboratoire, tels que le gaz sanguin artériel, et détermine que le patient est prêt à commencer les essais de sevrage. Une extubation plus précoce signifie que le transfert de l’unité de soins intensifs vers une unité de soins intermédiaires peut avoir lieu plus tôt. Il en résulte une réduction de la durée de la ventilation artificielle, la libération d’un lit d’unité de soins intensifs et un retour du patient à domicile plus rapide et facilité.
Dans la salle de dialyse
À l’étage de dialyse, un patient atteint d’une maladie rénale en phase terminale reçoit un traitement par dialyse. Ce patient vient à l’hôpital trois fois par semaine pour recevoir une dialyse ambulatoire. La surveillance et le signalement des pressions du dialysat et des signes vitaux du patient grâce à la connectivité des appareils facilitent la tâche du personnel de dialyse. En effet, ces valeurs sont communiquées au personnel infirmier et aux médecins traitants qui déterminent si les pressions se situent dans la plage normale ou si le patient présente une détresse qui nécessite une intervention plus rapide.
Les patients sous dialyse requièrent une surveillance régulière pour déterminer si leur pression artérielle est adéquate ou s’ils sont en décompensation. La surveillance des événements indésirables, comme les occlusions de fistules, est également essentielle pour garantir une prise en charge adéquate du patient. Dans ce cas, la même solution de connectivité des appareils est stratégique, car elle assure la communication des données vitales au personnel de soins à distance. Ce dernier peut ainsi assurer une surveillance continue des patients dont le traitement de dialyse peut durer plusieurs heures.
Dans l’unité médico-chirurgicale
Une patiente est ramenée de la salle de réveil postopératoire dans l’unité médico-chirurgicale (UMC). Il s’agit d’une femme âgée qui a subi une intervention bariatrique. De fait, elle restera en observation à l’UMC pendant plusieurs jours. Sous oxygène (canule nasale, trois litres par minute) à domicile, elle utilisait un masque de ventilation spontanée avec pression expiratoire positive (VS-PEP) pour l’apnée du sommeil obstructive (ASO).
Elle reçoit une dose orale d’un analgésique opioïde (p. ex., hydromorphone) pour soulager la douleur postopératoire. Elle est surveillée par oxymétrie du pouls en continu avec un moniteur cardiaque pour évaluer son cœur et sa respiration. Dans cette situation, la connectivité des appareils permet d’assurer une surveillance post-opératoire continue des changements dans la respiration et des faibles niveaux d’oxygénation qui peuvent être associés à une dépression respiratoire post-opératoire. Les données intégrées fournissent une mise à jour continue qui permet aux aidants de surveiller les tendances, comme la baisse de la saturation en oxygène ou de la respiration, et ainsi déterminer si la patiente requiert une intervention ou une réponse rapide.
Grâce à la connectivité des appareils médicaux, il est possible de transmettre les signes vitaux pour observation à n’importe quel système, comme un poste de surveillance à distance ou à l’appareil portable d’un clinicien.
Centraliser toutes les informations
Ces témoignages de patients illustrent la manière dont une solution de connectivité des appareils médicaux, indépendante des fournisseurs, permet de centraliser et de transmettre un ensemble de données quand et où elles sont les plus nécessaires, y compris vers le DME, les plateformes d’aide à la décision en matière de surveillance et les appareils mobiles. Une intégration étendue des appareils médicaux, indépendante des fournisseurs, permet aux praticiens de tirer profit des avantages potentiels des données médicales, afin de mieux concentrer leurs efforts et leur attention sur le patient, et non sur la technologie.
Que doivent rechercher les organisations lorsqu’elles choisissent une solution de connectivité des appareils médicaux ?
- L’accessibilité au sein du flux de travail clinique pour associer facilement le patient à un appareil médical et l’authentifier.
- La capacité à capturer toutes les données (signes vitaux, alarmes et formes d’ondes) où que se trouve le patient (soins intensifs, soins généraux ou autres établissements de santé en dehors de l’hôpital).
- Le formatage et la normalisation des données appropriées pour prendre en charge une multitude d’applications et de systèmes de réception (feuilles de calcul des DMP/DSE, systèmes d’information clinique départementaux, aide à la décision clinique, etc.) ainsi que l’analyse rétrospective ou les tendances d’un patient ou d’une population, utilisables pour améliorer la gestion des alarmes.
Une solution de connectivité des appareils médicaux indépendante des fournisseurs permet de connecter les données du patient en temps quasi réel pour fournir une image plus complète de sa santé. Elle permet ainsi potentiellement d’obtenir de meilleurs résultats tout en améliorant l’efficacité du personnel et des soins.
Donnez-nous votre avis. Qu’en pensez-vous ? En quoi la connectivité de vos appareils médicaux est-elle utile (ou pas) ? N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse MDIProdMgmt@philips.com pour partager votre point de vue.
À propos des auteurs
Libby Bucsi est responsable de la gestion des produits pour l'intégration des dispositifs médicaux chez Philips Capsule.
John Zaleski, Ph.D., NRP, FP-C, est responsable de l'informatique clinique chez Philips Capsule.
En savoir plus sur la connectivité des appareils et l’intégration des appareils médicaux Philips.
TÉLÉCHARGER